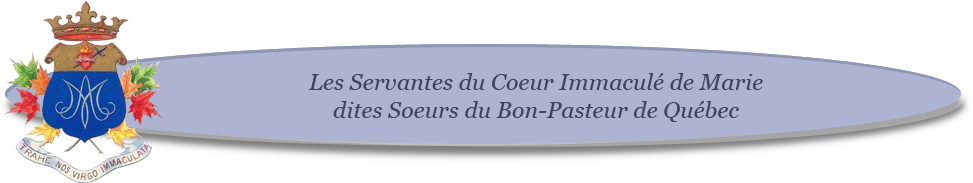
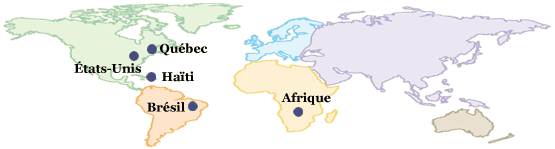
Québec, Canada
 |
Oeuvres sociales
| En 1850, l’Asile de Ste-Madeleine, la première œuvre de Marie-Josephte Fitzbach, accueille des femmes sortant de prison. Par la suite, la congrégation continue de répondre à des besoins de la société concernant certaines clientèles: prisonnières, orphelins, femmes et adolescentes en difficulté, mères célibataires et leurs enfants. |
| À l’aube des années 1980, l’époque des œuvres sociales d’envergure et des grandes maisons d’enseignement semble bien révolue, mais la mission des sœurs n’est pas terminée pour autant. Les religieuses s’engagent dans de nouvelles œuvres, certaines sous l’égide de la Congrégation, d’autres en partenariat avec des communautés religieuses et des organismes rendant service à des personnes seules ou dans le besoin. Aujourd’hui, elles offrent des services d’aide, particulièrement aux femmes dans le besoin. |
Liste des oeuvres sociales
|
|
Le 11 janvier 1850, Mme Roy et sa compagne, Mary Keogh, ouvrent l’Asile de Ste-Madeleine au 67, rue Richelieu, un refuge pour des femmes sortant de prison. Au cours des ans, la clientèle change. À sa fermeture en 1975, la Maison Marie-Fitzbach, ainsi nommée en 1962, accueille des jeunes filles de 13 à 18 ans vivant des problèmes personnels et/ou familiaux. |

Voir sur la carte |
|
|
En 1870, le Bon-Pasteur ouvre l’École de réforme qui reçoit les fillettes et les adolescentes perturbées ou ayant besoin d’un toit protecteur. Cette œuvre devenue l’Hospice St-Charles en 1876 reçoit ses dernières adolescentes en 1965. En 1975, après avoir été fermée quelques années, la maison devient une résidence pour les religieuses. |

Voir sur la carte |
|
|
Au milieu du 19e siècle, à Québec, les mères célibataires vont accoucher à l’Hôpital de la Marine ou à la prison. Vers 1870, deux médecins obtiennent de Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau l’autorisation d’ouvrir une maternité, rue Couillard, dirigée par les Sœurs du Bon-Pasteur. L’œuvre de la Miséricorde accueille les filles mères sans distinction de race, de religion ou de nationalité à partir du 8 septembre 1874. En 1929, l’Hôpital de la Miséricorde déménage Chemin Ste-Foy. Une décision gouvernementale conduit à la cessation des activités le 31 décembre 1972. De 1874 à 1972, cet hôpital universitaire a enregistré 46 122 admissons et 36 780 accouchements. Les dossiers des mères célibataires ont été transférés au programme Retrouvailles et recherche des antécédents du CIUSSS de la Capitale-Nationale. |

Voir sur la carte |
|
|
Jusqu’en 1901, les enfants nés à l’Hospice de la Miséricorde sont confiés aux sœurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Jésus à Québec. En réponse à la demande exprimée par Mgr Louis-Nazaire Bégin, le Bon-Pasteur fonde une œuvre qui accueille les enfants nés hors mariage. Après avoir logé à la Maison mère, puis, successivement rues des Remparts, Ferland et Couillard, la Crèche St-Vincent-de-Paul déménage Chemin Ste-Foy le 6 juillet 1908. À partir des années 1960, la libération des mœurs et une tolérance nouvelle incitent plusieurs mères célibataires à garder leur enfant. Ce facteur parmi d’autres amène la fermeture de la Crèche le 31 décembre 1972. Le personnel de la Crèche a pris soin de 38 672 enfants et facilité l’adoption de 26 276 d’entre eux. Les dossiers des enfants adoptés ont été transférés au Programme Retrouvailles et recherche des antécédents du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le bâtiment devient une résidence pour les religieuses de 1973 à 2008 et héberge l’Externat St-Jean-Berchmans de 1974 à 2003. |

Voir sur la carte |
|
|
|

Voir sur la carte |
|
|
En 1925, afin d’offrir un cadre plus stimulant aux enfants de la Crèche St-Vincent-de-Paul qui n’ont pas été adoptés, le Bon-Pasteur ouvre l’Hospice des Sts-Anges. Jusqu’en 1962, la maison accueille aussi des orphelins ou des enfants de familles temporairement en difficulté. |

Voir sur la carte |
|
|
|

Voir sur la carte |
|
|
En 1933, la Congrégation ouvre l’Orphelinat du Sacré-Cœur à Rivière-du-Loup afin d’y accueillir les orphelins de la région. De 1970 à 1976, l’établissement devient une maison de transition pour adolescentes en difficultés. Par la suite, de 1982 à 2002, la Maison Sacré-Cœur, reconnu comme centre d’accueil privé, reçoit des personnes âgées. |

Voir sur la carte |
|
|
En 1938, à Hawkesbury près d’Ottawa, la Congrégation ouvre l’Hôpital St-Cœur-de-Marie qui accueille les mères célibataires de la région. Les femmes mariées pourront venir y accoucher à partir de 1943. Les Sœurs du Bon-Pasteur quittent l’Ontario en 1970. |

Voir sur la carte |
|
|
Jusqu’en 1943, les jeunes filles mésadaptées sur le plan socio-affectif doivent aller à Montréal pour fréquenter un centre de réhabilitation. Cette année-là, à la demande du cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, o.m.i., la Congrégation accepte d’ouvrir la Maison Notre-Dame-de-la-Garde à Cap-Rouge. En 1975, à la suite d’une réforme gouvernementale qui tend à regrouper les institutions, un nouveau centre d’accueil, L’Escale, ouvre ses portes. Il accueille les jeunes filles de la Maison Notre-Dame-de-la-Garde et de la Maison Marie-Fitzbach. |

Voir sur la carte |
|
|
De 1948 à 1962, la Congrégation reçoit, à la Maternelle Marie-au-Temple, les enfants de la Crèche dont le développement demande des soins particuliers. |

Voir sur la carte |
|
|
Pour améliorer les soins donnés aux enfants, le Bon-Pasteur ouvre l’École de Puériculture le 16 février 1948. L’école est rattachée à la Crèche St-Vincent-de-Paul. Jusqu’à sa fermeture en 1971, les techniques les plus modernes en matière de soin des enfants y sont enseignés. Grâce aux services des puéricultrices graduées, la Crèche enregistre une baisse importante de la mortalité infantile. |

Voir sur la carte |
|
|
En 1949, la Congrégation ouvre une maternité pour les femmes mariées à Ville de Vanier, milieu ouvrier de Québec. L’Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance ferme ses portes en juin 1962. |

Voir sur la carte |
|
|
L’Hébergement Béthanie, situé au cœur du Vieux-Québec, accueille des patients recevant un traitement à l’Hôtel-Dieu de Québec et la personne qui les accompagne. |

Voir sur la carte |
|
|
La Maison Zoé-Blais est un centre de jour pour femmes monoparentales, à faible revenu ou immigrantes. Elle offre ateliers et activités auxquels s’ajoutent un comptoir vestimentaire et un comptoir alimentaire. |

Voir sur la carte |
|
|
La Maison Bon-Pasteur est un centre de jour qui offre de l’hébergement à l’occasion. Elle accueille des femmes seules ou avec des enfants. Depuis quelques années, elle ouvre ses portes à des hommes. Le centre de jour offre plusieurs activités. Le personnel religieux et laïc travaille en étroite collaboration avec les organismes du milieu. |

Voir sur la carte |
|
|
L’Hébergement Montfort accueille des patients recevant un traitement au Centre hospitalier de Jonquière et la personne qui les accompagne. |

Voir sur la carte |
|
|
L’Hébergement Bon-Pasteur accueille des femmes ayant besoin d’un répit de courte durée et ce, que ce soit au sortir de l’hôpital, suite à des difficultés conjugales ou à toute autre situation difficile nécessitant un lieu propice au calme et à la réflexion. On y dispense aide et écoute dans une ambiance familiale. Au besoin, les pensionnaires sont orientées vers d’autres services d’aide de la région. |

Voir sur la carte |
Enseignement et pastorale
| L’œuvre d’éducation des jeunes s’ajoute à la mission initiale. Ainsi dès le 7 janvier 1851, Mme Roy ouvre deux classes, l’une française, l’autre anglaise. Encouragés par Mgr Charles-Félix Cazeau, aumônier au Bon-Pasteur, plusieurs curés de campagne sollicitent la venue de religieuses enseignantes dans leur paroisse. C’est ainsi qu’en 1860, un groupe de sœurs prend la direction de Fraserville (Rivière-du-Loup). L’ère des « missions » vient de commencer. La Congrégation ouvre sa première école normale à Chicoutimi en 1907 afin de former de futures enseignantes pour pallier au manque d’institutrices en région. Au milieu du 20e siècle,  trois écoles ménagères reconnues pour la spécialisation de leurs programmes deviennent des instituts familiaux où l’on prépare les jeunes filles à leur futur rôle d’épouse et de mère de famille. trois écoles ménagères reconnues pour la spécialisation de leurs programmes deviennent des instituts familiaux où l’on prépare les jeunes filles à leur futur rôle d’épouse et de mère de famille.Vers 1950, les curés et les commissions scolaires de l’Abitibi, du Lac-St-Jean, de la région de Matane et même de la Colombie-Britannique continuent de solliciter la Congrégation pour l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire dans leurs paroisses. Mais voilà que la création du Ministère de l’Éducation en 1964 vient changer la donne. Des sœurs continuent d’enseigner au primaire dans les villages et plusieurs aident à l’animation pastorale à mesure que les prêtres résidents quittent les paroisses. Certaines se voient confier des mandats au niveau diocésain. D’autres s’adaptent au milieu des polyvalentes, des cégeps et des universités. On y retrouve des directrices, des enseignantes et des animatrices de pastorale. |
Les sœurs enseignantes ont quitté les écoles primaires et secondaires mais elles continuent de rejoindre aujourd’hui des individus ou des groupes par l’enseignement du français aux immigrants, de l’anglais et du Tai-Ji. |
Liste des lieux d'enseignement
|
|
Collège classique de 1947 à 1964. |

Voir sur la carte |
|
|
Juvénat de 1921 à 1968 puis résidence pour religieuses jusqu'en 2013. |

Voir sur la carte |
|
|
De 1974 à 2022, résidence pour religieuses. |

Voir sur la carte |